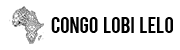« Toutes les paix ne sont pas de bonnes paix. Il y a des paix qui sont funestes. Il y a des paix qui sont vénéneuses. Il y a des paix qui sont pires que la guerre. Lorsque dans une société de paix soi-disant, vous avez des injustices, des crimes, de la corruption ou du népotisme, alors ladite société est en déliquescence. Et accepter cette paix, ce n’est rien d’autre que de la compromission et de la lâcheté… » Ce sont dans ces termes que le docteur Albert Ouedraogo nous alertait sur la paix dans le livre « Conversations Africaines ». Ce sont ces termes qui résonnent au regard de l’accord de paix RDC – Rwanda.
Cet accord de paix, signé à Washington le 27 juin 2025 entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda, est présenté comme un tournant historique. Orchestré sous l’égide des États-Unis, il prétend mettre un terme à trois décennies d’une guerre de basse intensité qui a ravagé la RDC. Cependant une analyse profonde de cet accord nous invite à penser que, loin d’être une solution, il s’apparente à un diktat qui institutionnalise la défaite congolaise, en sacrifiant la justice, la souveraineté et le développement durable sur l’autel d’une stabilité de façade, conçue pour servir des intérêts étrangers.
Un compromis pragmatique ?
Le 27 juin 2025, dans les salons feutrés de Washington, les ministres congolais et rwandais des affaires étrangères ont apposé leur signature sur un document intitulé « Accord de Paix Global ». La médiation américaine est saluée par la diplomatie internationale comme une avancée majeure pour la stabilisation de la région des Grands Lacs. Les termes de l’accord, tels que rapportés, s’articulent autour de trois axes :
Présenté comme un compromis pragmatique, cet accord est en réalité l’aboutissement logique d’une stratégie de longue haleine visant à affaiblir la RDC pour mieux contrôler ses richesses.
L’axe sécuritaire : Création de patrouilles mixtes FARDC-RDF dans les provinces du Kivu et intégration d’éléments des groupes armés pro-rwandais au sein de l’armée congolaise, en échange d’un désarmement supervisé.
L’axe économique : Mise en place d’un «cadre d’intégration économique régional» pour l’exploitation et la commercialisation des minerais du Kivu, avec des garanties de traçabilité impliquant des entreprises anglo-saxonnes et des structures de traitement rwandaises.
L’axe judiciaire : Aucune référence à la justice, à la vérité ou encore à la réconciliation, aucune référence non plus pour des poursuites pénales contre les principaux responsables des crimes commis depuis 1996, et cela, sans doute au nom de la « nécessité de regarder vers l’avenir ».
Présenté comme un compromis pragmatique, cet accord est en réalité l’aboutissement logique d’une stratégie de longue haleine visant à affaiblir la RDC pour mieux contrôler ses richesses.
La légalisation d’un ordre néocolonial
Analyser cet accord au-delà de sa rhétorique lénifiante révèle une architecture de la soumission. Les enjeux véritables ne sont pas la paix, mais la légalisation d’un ordre néocolonial.
L’État congolais n’est plus souverain ; il devient le gestionnaire local d’un programme de prédation international.
L’enjeu de la justice bafouée
La première et la plus brutale des réalités de cet accord est son silence assourdissant sur les millions de morts congolais, les millions de femmes violées et les millions de déplacés. En offrant une amnistie de fait aux architectes de cette tragédie, l’accord entérine une paix sans justice. Il s’agit d’une prime à l’agresseur, où les forces mandataires du Rwanda et de l’Ouganda, instruments d’une guerre de prédation, sont non seulement absoutes de leurs crimes, mais récompensées par une légitimation politique et une participation officielle à la gestion du territoire qu’elles ont mis à sac. Pour la RDC, cette impasse sur la justice n’est pas un simple compromis ; c’est une négation de son histoire et une interdiction de faire son deuil, condition sine qua non à toute réconciliation authentique et à la refondation d’un pacte social.
L’enjeu de la souveraineté liquidée
Le concept de « gestion conjointe » des ressources naturelles est une ruse sémantique pour masquer la liquidation de la souveraineté congolaise. La RDC, un État délibérément « fabriqué » comme raté par des décennies de déstabilisation, se voit contrainte de partager contractuellement le contrôle de ses propres richesses avec son agresseur et les parrains de celui-ci. Le «cadre d’intégration économique régional» n’est rien d’autre qu’une enclave économique où le droit congolais sera subordonné aux intérêts d’un consortium d’acteurs externes. L’intégration des miliciens dans l’armée nationale est une autre facette de cette abdication : elle institutionnalise un cheval de Troie au cœur de l’appareil sécuritaire, garantissant sa faillite permanente et empêchant l’émergence d’une armée républicaine capable de défendre l’intégrité du territoire. L’État congolais n’est plus souverain ; il devient le gestionnaire local d’un programme de prédation international.
L’enjeu du développement-mirage
L’accord met en avant le « développement du secteur minier » comme moteur de la prospérité. C’est le mythe classique qui a justifié l’exploitation de l’Afrique depuis des siècles. Ce modèle ne vise pas le développement durable des populations congolaises, mais l’optimisation des chaînes d’approvisionnement pour les industries mondiales. Il assure la pérennité d’une économie de rente extravertie, sans transformation locale, sans création d’emplois décents et sans investissement dans les infrastructures sociales (écoles, hôpitaux). En liant la paix à ce modèle, on condamne la RDC à rester un simple fournisseur de matières premières brutes, perpétuant la paupérisation organisée de ses citoyens, rendus dépendants de l’aide humanitaire sur leurs propres terres regorgeant de richesses.
L’impératif de l’intelligence stratégique
Cet événement est riche d’enseignements pour les leaders, les intellectuels et les peuples africains.
La souveraineté n’est jamais acquise. Elle exige un leadership visionnaire, une vigilance constante et une capacité à refuser les compromis qui aliènent les droits fondamentaux du peuple.
Sur la nature des médiations internationales :
Une paix négociée sous l’égide d’une puissance ayant des intérêts stratégiques et économiques dans la zone de conflit risque toujours de privilégier la « stabilité des affaires » à la justice pour les peuples.
Sur la souveraineté comme combat permanent :
La souveraineté n’est jamais acquise. Elle exige un leadership visionnaire, une vigilance constante et une capacité à refuser les compromis qui aliènent les droits fondamentaux du peuple, notamment le contrôle sur sa terre-mère.
Sur l’impératif de l’intelligence stratégique :
Il est crucial de maîtriser les modes opératoires de l’adversaire, qui use de la ruse et du mensonge, présentant des diktats comme des accords et des capitulations comme des compromis. La « guerre des idées » est aussi importante que la confrontation militaire.
Une réorientation stratégique est impérative
Face à ce qui s’apparente à un acte de reddition, une réorientation stratégique est impérative.
Il est vital d’organiser des contrepouvoirs citoyens pour déconstruire le narratif officiel de l’accord, à travers notamment des collectifs citoyens à travers le monde.
Pour les acteurs politiques congolais :
Il faut avoir le courage politique de soumettre cet accord à un débat national transparent. En parallèle, l’urgence est de lancer un véritable projet de refondation de l’État basé sur la sécurisation des citoyens par une armée réformée, une gestion souveraine des ressources et un contrat social renouvelé.
Pour la société civile et la diaspora :
Il est vital d’organiser des contrepouvoirs citoyens pour déconstruire le narratif officiel de l’accord, à travers notamment des collectifs citoyens à travers le monde. C’est le sens et la proposition de « l’appel pour la dignité, la souveraineté et la refondation » du mouvement Likambo Ya Mabele. Il s’agit de mener une campagne internationale pour exposer ses failles et de promouvoir une alternative crédible, articulée autour de la justice, de la réparation et de la souveraineté.
Pour les universitaires et chercheurs :
La tâche est de produire des analyses critiques et documentées des mécanismes de prédation et des stratégies de fabrication des « États ratés ». Le livre du philosophe et analyste politique Jean-Pierre Mbelu, « la fabrique d’un Etat raté» est un bon point de départ. Ce savoir doit irriguer le débat public et armer intellectuellement une nouvelle génération de leaders.
La main à la pâte
L’accord de Washington n’est pas une fatalité. C’est une proposition. L’accepter serait pour la RDC choisir la servitude volontaire. Le refuser sera difficile et coûteux, mais c’est la seule voie pour reconquérir sa dignité et maîtriser son destin. La véritable paix ne se signe pas dans les capitales étrangères sous la pression des maîtres du monde ; elle se construit de l’intérieur, par une insurrection des consciences, par la force d’un peuple uni qui décide de se réapproprier son histoire et sa terre. La question posée aux Congolais n’est pas de savoir s’ils peuvent supporter la paix, mais s’ils peuvent encore supporter l’injustice.
Comme nous y encourage le politologue congolais Mufoncol Tshiyoyo: « L’avenir du Congo et de l’Afrique exige, d’un côté, l’absence des populations spectatrices, inertes et, de l’autre, la présence des populations actant, agissant, actrices. Tout le monde devrait mettre sa main à la pâte. » La lutte, aujourd’hui, a changé de forme, mais son objet demeure : la souveraineté pleine et entière.