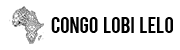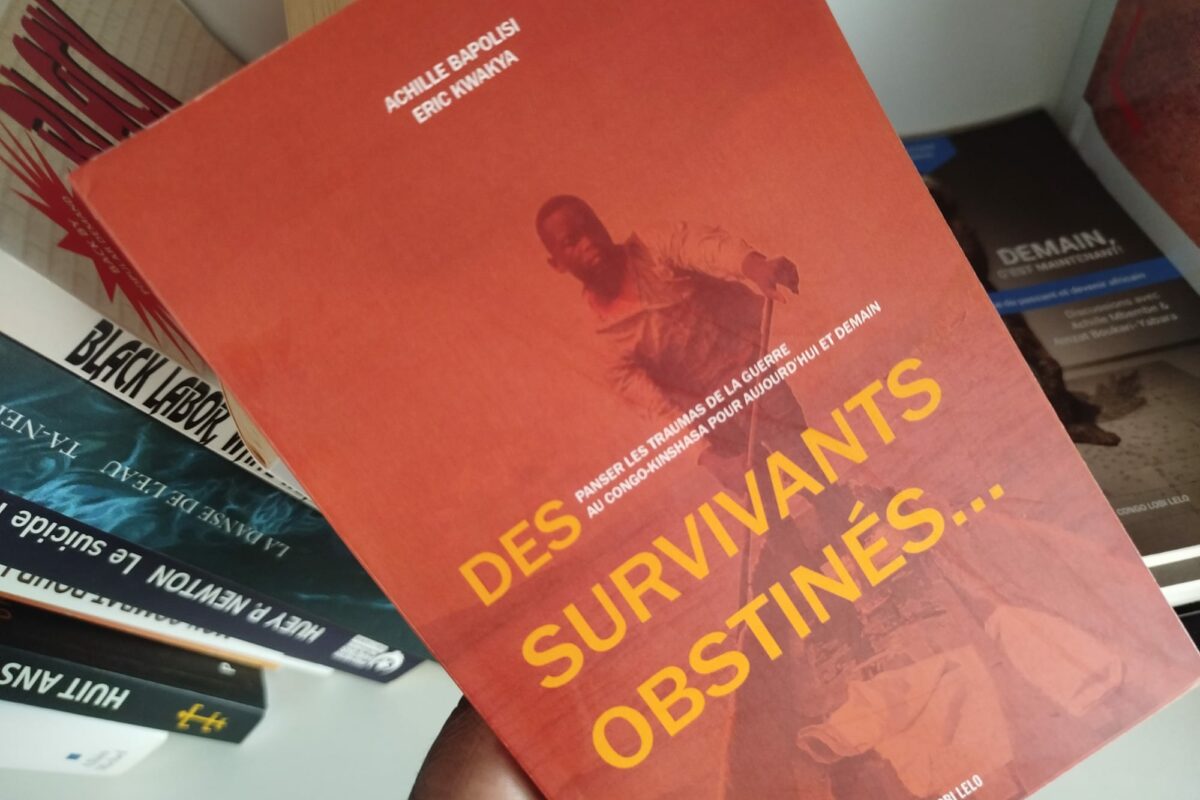Le Centre Neuro-Psychopathologique (CNPP) de l’Université de Kinshasa a organisé deux journées de consultations gratuites les 27 et 28 mars 2025, dédiées à la sensibilisation sur la santé mentale et la santé du cerveau. Selon Radio Okapi, « des centaines de personnes ont afflué pour bénéficier des services offerts par le CNPP. Les effets de la guerre qui sévit en RDC, par exemple, peuvent être à l’origine de troubles neurologiques, ce qui a motivé cette initiative, souligne le médecin directeur du centre, professeur Daniel Okitundu : »Le CNPP est une institution de santé mentale et de santé du cerveau qui est encore mal connue de la population. À cause des effets de la guerre, il y a des gens qui sont en détresse psychologique et qui peuvent avoir des troubles mentaux et de comportements sans savoir exactement où aller. »
Dans notre livre « Des survivants obstinés » (ed. Congo Lobi Lelo, 2021), nous abordons les questions et enjeux de la santé mentale en RD Congo. Dans cet extrait, Dr Achille Bapolisi, médecin psychiatre à l’Hôpital Provincial Général de Bukavu, au Congo-Kinshasa, nous aide à comprendre la notion de trauma collectif.
—————–
Votre pratique clinique à Bukavu, vous a poussé à travailler sur le trauma collectif. Qu’est-ce que le trauma collectif, pouvez-vous nous définir ce concept ? Et pourquoi il est si prégnant à Bukavu ?
En effet, travailler et vivre dans mon pays m’a vite fait réaliser que ce trauma ne concernait pas seulement des individus pris isolément, mais aussi des communautés entières. J’observais des changements bien évidents dans la société. A titre d’exemple, une augmentation de la violence civile, de l’alcoolisme, une apathie générale. C’est ainsi que mon attention a commencé à être attirée par cet aspect de « trauma collectif ».
De façon simple, un trauma collectif est un trauma qui affecte une communauté soit au niveau d’un groupe identitaire (tribu, race, ethnie,…) ou de la société. Comprendre le trauma collectif dans une population aide un peu à expliquer ces phénomènes de société qui contribuent au cercle vicieux de l’insécurité et de la pauvreté. Ceci nous aiderait à soigner cette société.
Comment distinguez-vous ces traumas collectifs, à la différence d’une angoisse collective par exemple. Quels sont les marqueurs qui permettent de diagnostiquer les traumas collectifs dans la population congolaise ?
De façon très sommaire, on a, en effet, identifié des marqueurs qui nous permettent d’identifier un trauma collectif. Ces marqueurs sont de trois ordres: Les narrations collectives, les émotions collectives et les modèles comportementaux collectifs.
Les narrations collectives tournent autour des thèmes tels que le deuil, le désespoir, la victimisation, la culpabilité et la honte. Les émotions collectives sont la colère, la peur, la tristesse, l’apathie. Les modèles mentaux collectifs peuvent se présenter sous formes d’idéologie, des préjugés, des vérités.
Quand on observe et on écoute une bonne partie de notre population, on se rend vite compte qu’elle est caractérisée par la présence de ces marqueurs.
Pourquoi estimez-vous que le Congo-Kinshasa a tous les signes du trauma collectif ?
Comment peut-il en être autrement? Non seulement nous avons, à tous les niveaux de la société, tous ces marqueurs que je viens de décrire mais aussi nous sommes en train de vivre des conflits armés et des massacres des populations entières.
C’est par millions qu’on compte les morts au Congo. A ceci, il faut ajouter un antécédent trop lourd de despotisme politique, précédé de la colonisation la plus sanguinaire et acculturante de l’histoire, qui est elle-même précédée des années d’esclavage et de traite négrière.
Comment peut-il en être différemment? Surtout quand un silence profond entoure cette lourde histoire.