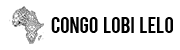Amilcar Cabral nous invite à concevoir la libération comme un acte de culture. Il disait exactement ceci : « Un peuple qui se libère de la domination étrangère ne sera libre culturellement que si, sans complexe et sans sous-estimer l’importance des aspects positifs des cultures de l’oppresseur et des autres cultures, retourne vers les chemins glorieux de sa propre culture, qui est nourrie par la réalité de son environnement et qui neutralise aussi bien les influences néfastes et tout assujettissement à la culture étrangère. Ainsi, il peut être dit que si la domination impérialiste a le besoin vital de pratiquer l’oppression culturelle, la libération nationale est nécessairement un acte culturel [1] . » Comment la culture peut-elle nous aider à lutter contre l’oppression et à renverser les rapports de force en notre faveur ?
Il faut la redécouvrir. Il faut redécouvrir ce que signifie bomoto. Quand dit-on que telle personne « aza moto » (que telle personne est un humain dans notre culture) ? Qu’est-ce que le bomoto chez nous ? Voilà des questions que nous ne nous posons presque plus. Un Muntu dans ma culture, c’est d’abord quelqu’un qui affirme ses origines. C’est quelqu’un qui est capable de dire : « Je viens de… » Un Muntu a un fief, une terre, un ancrage, des racines. Un Muntu se situe et sait jusqu’où ses racines sont plongées dans la terre de son fief. Un Muntu, c’est aussi celui qui sait manger, boire et (s’asseoir ou) vivre avec les autres. Ici, il faut comprendre le savoir comme la capacité à initier des processus qui conduisent à la production du manger, du boire et du »vivre ensemble ». (Etre un humain, nkumanya mua kudia, kunua, ne kusomba ne bantu.)
L’un de mes aînés, Maître Mukenge Ndibu, exprime merveilleusement bien ce processus de production de la nourriture et du »bien vivre ensemble » tout en s’affirmant comme humain au travers de ce petit discours : « Biwakula ne Mukenge Ndibu, wamanya ne udi muakule ne muntu. Mukenge Ndibu uya muitu, ukuma makanakana ne mfiondo ; upatuka mu mpata, mamanye kutula butundo ; ulua pambelu, Mukenge mananye kusomba ne bantu ». Il décrit ce processus tout en s’affirmant comme »un animal loquens ». Il dit plus ou moins ceci : »Si tu parles avec Mukenge Ndibu, sache que tu as parlé à un muntu. Mukenge Ndibu va en forêt et il tue les oiseaux (makanakana et fiondo) ; il passe par la savane et ramasse le champignon (butondo) ; de retour à la maison, il sait comment vivre avec les autres (bantu). »
Dans cet ordre d’idées, le Muntu est celui qui a la maîtrise des espaces forestiers où sa chasse peut être fructueuse, des mois de l’année où il peut ramasser ou cueillir ce que produit la savane tout en restant tourné vers le partage rendant »le vivre ensemble » agréable. Il aime tellement »le vivre-bien-ensemble » qu’il est prêt à partager ce qu’il produit avec plusieurs autres (bantu). Il aime le principe : Tshiadime umue, tshiadia banyi. (Ce qu’un Muntu cultive peut être mangé par plusieurs). Pour éviter de tomber dans le parasitisme, nous nous avons créé cet autre adage : Tshiadima bangi, tshiadia banyi. (Ce qui est cultivé par plusieurs (bantu) peut être mangé par plusieurs (bantu)). Mais ce principe existait déjà dans notre culture sous plusieurs formes. Les enfants d’une même famille qui allaient aider leur maman au champ disaient : Tudimine baba, nkukudia kuetu. (Aidons maman à cultiver, il y va de notre manger). Un adage dit, pour exprimer la force qui vient de l’union : Nkunde ya banyi ibobele ne mate. (Les haricots de plusieurs sont cuits par leur salive). Il y a là l’expression d’un solidarisme qui a aidé et aide encore un pays comme le Congo-Kinshasa à tenir le coup. Néanmoins, ce solidarisme reste familial, clanique ou ethnique. L’institutionnaliser donnerait au pays de Lumumba une matrice organisationnelle différente de celle qui, au cœur du néolibéralisme, conduit à la guerre perpétuelle de tous contre tous.
Maîtriser les modes de production du manger, du boire et du »bien-vivre-ensemble » fut essentiel au Muntu de nos villages. C’est la raison pour laquelle, dans notre culture villageoise ancienne, on ne pouvait pas donner en mariage une femme à un homme qui ne savait pas construire sa case, qui ne savait pas tendre des pièges, qui ne savait pas aller à la pêche, ou qui ne savait pas aller à la chasse. Pourquoi ? Parce que quand il sera marié, comment va-t-il nourrir sa femme ?
Le solidarisme reste familial, clanique ou ethnique. L’institutionnaliser donnerait au pays de Lumumba une matrice organisationnelle différente de celle qui, au cœur du néolibéralisme, conduit à la guerre perpétuelle de tous contre tous.
Aujourd’hui il y a des Congolais et des Congolaises qui prient en disant Deu du ciel « kita osala » (que l’on peut traduire par, descend – du ciel – pour travailler pour nous) alors que dans nos traditions, la reconnaissance de Dieu comme créateur, comme Kafukela muena bana, muen a bidi panuapa bionso, ne remettait pas en question la maîtrise des processus de production de la vie sous toutes ses formes. On était, entre autres un Muntu parce que l’on avait maîtrisé les processus de production de la nourriture. Même s’il s’agissait souvent des processus qui conduisaient à l’économie de subsistance, on savait nourrir sa femme, ses enfants et leur procurer une vie digne.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? On se marie pour vivre du parasitisme. C’est ainsi que la famille, dans nos villages, dans nos villes, en Afrique, et au Congo, est en train de devenir un poids. Il y a des références ancestrales traditionnelles que l’on est en train d’oublier, même si, avec la guerre, nos villages ont connu l’exode rural. Voila pourquoi nous, nous en appelons à l’avènement d’un Etat de droit qui favorise le chemin du retour au village. Nous nous insérons dans un projet dénommé »de la ville au village » et cela ne peut être possible que si nous avons des routes et des autoroutes de communication ainsi que des énergies renouvelables.
Enfin, être Muntu, c’est aussi participer et donner un sens au vivre ensemble. Maîtriser le vivre ensemble, cela veut dire quoi ? Cela signifie maîtriser le respect mutuel quand on est avec les autres : Kutua nkushilangana miji, ce qui signifie piler (quand on est à deux), c’est laisser à chacun son tout (d’user de son pilon)). Pour savoir comment vivre avec les autres, on doit avoir maîtrisé certaines règles sociales et certaines règles du vivre ensemble. Savoir accorder la place qu’il faut au bakulu tout en sachant que tshikulu nlungenyi, kuyi ne lungenyi kuladi panu, comme dirait Mukenge Ndibu. (Ce qui donne le droit d’aînesse, c’est la sagesse ; si tu n’es pas sage, tu ne vivras pas longtemps ici bas.)
Et quand on est en face de l’autre, on le respecte comme Muntu Wa Bende (« un humain-d’autrui-de Dieu »). C’est-à-dire qu’on lui reconnaît l’humanité comme étant un don, comme une humanité qui vient d’ailleurs, qui vient de l’Autre. On ne peut pas disposer du Muntu Wa Bende comme on l’entend. L’affirmation de ses racines, le fait de savoir maîtriser les processus de production de nourriture, de savoir manger et de vivre avec les autres, voilà ce qui fait un Muntu.
Par ailleurs, savoir vivre avec les autres ne nous enferme ni dans un particularisme local ni dans des identités meurtrières comme le dirait Amine Maalouf dans des identités meurtrières. Au contraire, le fait de savoir vivre avec les autres et de savoir construire le bien-vivre-ensemble nous ouvre à la pluralité des autres identités.
[1] Amilcar Cabral, « Libération nationale et culture », dans Unité et lutte, Tome 1, Paris, Maspero, 1970, p336-357.
Jean-Pierre Mbelu (entretiens avec Esimba Ifonge), A quand le Congo ? (Réflexions & propositions pour une renaissance panafricaine), Congo Lobi Lelo, 2016. Achetez le livre.